Par Bruno Mori
L’homme et le laïque
Les historiens nous assurent que Jésus de Nazareth n’est pas un mythe, mais un personnage qui a réellement existé et qui a vécu en Palestine au temps de l’empereur Tibère. Même si les données historiques vérifiables sur ce personnage sont minimes, de l’impact de son message et du témoignage de ses premiers disciples, nous pouvons déduire qu’il a été un homme extraordinaire, un maître d’humanité et un spirituel épris de Dieu.
De ce que les récits évangéliques racontent et de ce que nous pouvons logiquement déduire de l’esprit et de l’ensemble des valeurs qu’il a laissées, nous pouvons dire que Jésus de Nazareth était presque certainement un homme issu du peuple, sans grande éducation, l’aîné d’une modeste et nombreuse famille de cultivateurs-artisans (au moins quatre frères et quelques sœurs) que les évangiles situent dans le petit village rural de Nazareth, en Galilée. Le Jésus adulte au début de la trentaine dont parlent les évangiles, était probablement un homme marié, de ceux qu’aujourd’hui on qualifierait de laïc engagé au plan social, plus qu’au plan religieux. Un laïc avec une nette tendance « anticléricale », comme il apparaît dans certaines de ses paraboles (comme, par exemple, dans la parabole du bon Samaritain, en Lc.10) et dans les nombreuses et vigoureuses discussions qu’il a eues avec les représentants de la religion juive de son temps, ainsi que dans les sévères critiques qu’il leur adresse.
Jésus n’a jamais accepté pour lui les égards, les titres, les marques d’honneur réservés aux gens importants (prêtres, scribes, dignitaires civils et religieux) de l’époque. Il a toujours été un homme parmi les d’autres et comme les autres. Il n’a donc pas été l’homme du sacré, mais l’homme du profane. C’est dans la rue, dans les marchés, dans les bains et sur les places publiques qu’il a rencontré les humains et leurs misères. C’est avec les gens ordinaires du peuple et surtout avec les indigents, les souffrants et les malheureux qu’il a vécu sa relation amoureuse avec le Mystère de Dieu et a ouvert à tous un chemin pour l’atteindre.
Même si Jésus de Nazareth est né de parents très pieux et élevé dans une pratique religieuse probablement très stricte, il ne s’est jamais fait emprisonner par la religion. Il a toujours manifesté une attitude très libre et très indépendante vis-à-vis des obligations et des interdits qu’elle imposait à ses fidèles. Il a toujours eu des relations détachées, distantes, critiques et conflictuelles, autant avec les membres de sa famille naturelle, qu’avec ceux de la religion officielle et ses représentants.
Si Jésus a été un homme profondément religieux, on peut affirmer que sa religiosité ne lui venait pas de son adhésion à une religion et à ses pratiques, mais de l’originalité de ses convictions, de la qualité de son humanité, de l’intensité de sa vie spirituelle et de l’intimité amoureuse avec laquelle il vivait sa relation personnelle avec le Mystère Ultime de Dieu qu’il appelait « Père ».
Jésus a été l’homme de la spiritualité et non pas un homme de la religion. Il n’a jamais fait partie de la caste des prêtres, des scribes ou des lévites. Comme juif, il n’a été ni particulièrement religieux, ni spécialement observant. Il n’a jamais été un homme « dévot » et « pieux », dans le sens que l’on confère habituellement à ces qualificatifs. Il a facilement pris ses aises avec la religion et ses distances avec ses pratiques. Il n’a pas hésité à critiquer la religion juive de son temps et à relativiser l’importance et la fonction du Temple dans la relation de l’homme avec la divinité. Son enseignement n’a jamais été axé ni sur la nécessité de l’observance des prescriptions de la Torah, mais sur la nécessité de l’ouverture aux autres et donc du soin et de l’amour pour toutes les créatures de Dieu.
Jésus ne s’est jamais senti concerné par les normes cultuelles qu’il a systématiquement et sciemment transgressées (ablutions rituelles, obligation du jeûne, observance du sabbat, etc.). Il s’est senti totalement libre face aux tabous alimentaires ou autres concernant la fréquentation des femmes et des païens. Il ne s’est jamais préoccupé des normes religieuses déterminant les conditions de pureté et d’impureté. Il s’est insurgé de toutes ses forces contre le formalisme de la caste sacerdotale ; contre le fondamentalisme, l’hypocrisie, la vanité, la soif de pouvoir et d’honneurs de la part des autorités religieuses de son temps. On peut donc dire, et ses adversaires ne se sont pas gênés de le lui faire remarquer, qu’il a été est un bien mauvais pratiquant.
Jésus a déplacé le « sacré » de la religion et du Temple pour le placer dans l’être humain et dans la création. Comme le disait si bien Maria Lopez Vigil, « lorsqu’aucune personne n’est sacrée, toutes les personnes deviennent des êtres sacrés. Lorsqu’aucun objet n’est sacré, toute chose devient l’objet de notre attention et de notre soin. Lorsqu’aucun temps n’est sacré, tous les jours qui me sont donnés à vivre se transforment en temps béni et sacré au cours duquel je peaufine la qualité de mon humanité. Quand aucun lieu n’est sacré, je peux voir dans l’Univers le temple sacré et merveilleux de la présence de Dieu. »
À cause de ses idées nouvelles, de ses intuitions innovatrices, de ses prises de position critiques et contestataires, Jésus a été un homme (ou un prophète) dérangeant, qui a suscité l’opposition et l’hostilité des autorités religieuses et politiques de son temps qu’il déstabilisait et qui ont fini par l’éliminer. C’est pour cette raison que la figure et l’œuvre de l’Homme de Nazareth resteront à tout jamais marquées par ce conflit et cette opposition radicale. C’est pour cette raison que la communauté de ceux à qui Jésus a laissé sa pensée et son esprit en héritage et qui marche sur sa « Voie » sera toujours réfractaire aux structures, aux dynamiques et aux politiques de la religion.
Jésus de Nazareth a été l’initiateur d’un mouvement populaire qui n’admet pas de différences, de hiérarchies et d’inégalités entre les êtres humains. Il s’agissait de toute évidence d’un mouvement laïque et séculier qui s’est formé et qui s’est déployé en marge et en dehors de toute religion. Jésus n’a pas fondé une nouvelle religion. Les religions établissent catégories, rangs, classes, ordres, hiérarchies, supériorités, différences, exclusions. Rien de tel dans le monde voulu par Jésus, où tous se sentent égaux ; où tous se considèrent frères et sœurs ; où chacun se met au service de tous les autres ; où toute recherche de prestige, de pouvoir, de domination et de supériorité est bannie et condamnée ; où toute autorité naît spontanément comme une demande de services de la part de la communauté elle-même.
La religion chrétienne et impériale postérieure, croyant lui rendre hommage, a fait de lui un « grand prêtre », paré de pouvoirs sacrés et sacerdotaux. Ce que Jésus ne fut jamais ; ce qu’il n’a jamais voulu être, ce qu’il aurait considéré comme un affront infligé à son indépendance, à sa laïcité et à ses convictions les plus profondes.
Le génie
La qualité humaine de Jésus, la nouveauté et l’originalité de son message ont jailli de sa perception personnelle de Dieu qu’il a intuitivement ressenti et découvert comme Source d’une qualité supérieure d’amour, propre à la nature de Dieu : l’amour gratuit, inconditionnel et désintéressé. Pour les hommes de la modernité qui, grâce à la nouvelle cosmologie, ont eux aussi découvert cette caractéristique et cette qualité « amoureuse » de l’Énergie Primordiale de Fond qui régit toute la réalité cosmique, la figure de Jésus de Nazareth peut devenir alors une « révélation » unique et une « incarnation » particulièrement exemplaire de la présence en ce monde de cette forme supérieur d’amour dont seul l’humain est capable ici sur terre.
Jésus serait alors le génie qui, le premier, nous a ouvert les yeux et qui a attiré notre attention sur l’exploit extraordinaire accompli par le processus évolutif de l’Univers lorsqu’il a réussi à faire « émerger » dans la réalité cosmique une créature capable d’une telle qualité d’amour.
Pour Jésus, cette qualité d’amour que le « miracle » évolutif a inséré et installé dans la pâte de la réalité cosmique et particulièrement dans le cœur de l’homme, constitue le seul levain capable de la faire lever et de parachever son mouvement évolutif, en le pétrissant de la substance amoureuse de Dieu.
Jésus est ce chef-d’œuvre d’homme qui a consacré son existence et toutes ses énergies à la tâche d’assimiler cet amour dans son cœur, son esprit et ses attitudes et de le concrétiser dans ses choix, dans son comportement et dans toutes ses relations.
Jésus est le prophète génial par lequel cette forme supérieure de l’amour est proclamée, annoncée et proposée à tous les humains comme un « chemin » ou une « voie », certes ardus et difficiles à parcourir, mais d’une efficacité assurée pour arriver à construire un monde meilleur et une humanité renouvelée.
La construction d’un monde nouveau, animé et régi par les dynamiques de l’amour gratuit et inconditionnel, a toujours constitué le grand rêve de sa vie qu’il avait appelé le « Royaume de Dieu » parmi les hommes.
Le maître d’humanité
Dans les Évangiles, Jésus s’est présenté comme un maître et un guide de conduite humaine inspirée par l’amour. Ses disciples ont vu en lui un genre de prophète réformateur de la religion juive de son temps, à laquelle il appartenait par sa naissance, mais à laquelle il n’a jamais pleinement adhéré par son cœur ; de laquelle il n’était pas spécialement observant ; qu’il ne s’est pas privé de critiquer ; à laquelle il s’est continuellement confronté et opposé ; et qui a fini par l’éliminer.
Jésus n’a jamais proposé des croyances, mais des attitudes, des comportements, un style de vie, une vision et une approche nouvelle de la Réalité. Pour lui, ce qui est « sacré » n’est ni Dieu, ni la religion, ni le temple avec ses sacrifices, son culte et ses rites, mais l’être humain, spécialement s’il est pauvre, faible, malade et malheureux. Et, en ce sens, on doit affirmer que le projet de Jésus (l’instauration du « Royaume de Dieu » sur terre) est finalement un projet profane d’« humanisation » et non pas un projet religieux de « sanctification » confié à une institution religieuse.
Alors que les religions cherchent à rendre possible de bonnes relations entre les dieux et les hommes, en offrant à ces derniers les moyens d’approcher et d’amadouer une divinité totalement imaginaire, Jésus a cherché surtout à rapprocher l’homme de l’homme, en faisant comprendre les raisons qui doivent pousser les humains à se « rapprocher » (à devenir « prochain ») et à s’aimer les uns les autres.
Alors que les religions proposent une « divinisation » impossible de l’homme, Jésus a proclamé la possibilité d’une meilleure forme d’« humanisation », en annonçant à ceux et celles qui voulaient bien l’écouter qu’il leur était possible de devenir de meilleures personnes et de croître et d’évoluer vers des postures plus accomplies d’humanité. Ainsi, Jésus n’a pas voulu rendre les personnes plus religieuses, mais plus humaines.
Jésus cherchera également à démanteler les préjugés de la mentalité machiste, patriarcale de la religion et de la culture de son temps, centrées sur le pouvoir, l’autorité et la supériorité de la figure masculine du « père ». Pour Jésus, le titre de « père » doit être réservé exclusivement à Dieu. Il aura l’audace d’affirmer que personne n’a le droit de se faire appeler par ce nom et de s’appuyer sur la puissance de sa fonction reproductrice pour s’imposer aux femmes, les soumettre et les tyranniser.
Pour le Maître de Nazareth, les grands, les importants ne sont pas les « pères », les « mâles » en autorité ou qui ont réussi à grimper l’échelle hiérarchique du pouvoir, mais les enfants, les petits, les pauvres, les faibles, les affligés, les femmes, parce que c’est à eux et à elles qu’appartient le « Royaume de Dieu ».
Le spirituel et l’homme de Dieu
Jésus a été l’homme totalement ouvert à la présence amoureuse de Dieu dans sa vie. Cette attitude intérieure l’a conduit à réaliser un style de vie humaine entièrement déployé dans les harmoniques du don de soi, de la compassion et de l’amour. Jésus n’a pas seulement enseigné ce nouveau mode de vivre, mais il l’a incarné dans le vécu quotidien de son existence. C’est pour cela que Jésus de Nazareth restera dans la mémoire chrétienne un modèle, non pas de religiosité, mais d’humanité.
Le Dieu aimé et annoncé par Jésus de Nazareth est aux antipodes du « Theos » inventé par les religions. C’est un autre Dieu. C’est un Dieu inédit. C’est un Dieu qui ne sort pas de la spéculation ou de l’imagination de l’homme, mais de son cœur. Ce n’est pas un concept, une idée, mais un sentiment, un pressentiment, un élan intérieur, une invocation, un soupir d’amour, une possibilité d’extase. C’est le Mystère naturel d’une Énergie ou d’une Présence amoureuse qui est partout, qui soutient tout, qui est dans la nature des choses, qui est donc en nous et fait partie de nous et qui, d’après Jésus, est capable de nous vivifier, de nous accomplir, de nous élever et de nous « spiritualiser ».
Il s’agit cependant d’un Mystère qui n’a absolument rien de « religieux », ni rien à faire avec quelque religion que ce soit. Sa demeure n’est pas dans les temples, les sanctuaires, les tabernacles, les rites, les sacrements, mais elle est là dehors, dans la nature, dans le monde, dans les fleurs, les bois, les montagnes et les rivières, dans la vie, dans ma vie, dans mon cœur, dans tout ce qui existe et qui constitue la substance et la grandeur de l’Univers.
Le Dieu de Jésus est l’âme et l’essence la plus profonde de toute chose. Car il imprègne de sa force et de son esprit d’attraction et d’amour tout ce qui existe. C’est pour cela que son Dieu nous est intérieur, intime, familier, père, mère, ami, amant, vers lequel on peut aller avec la confiance et l’abandon d’un enfant.
Jésus s’est plu à dévoiler à ses disciples les caractéristiques du Dieu qui habitait son cœur et son esprit. Et voilà pourquoi le Dieu de Jésus est pour les chrétiens un Être qui aime gratuitement, avec la tendresse d’une mère et l’ardeur d’un père. C’est un Dieu qui ne juge personne ; qui accueille tout le monde à bras ouverts, sans arrière-pensée et sans discrimination ; qui pardonne sans mesure ; qui veut le bonheur de tous ; qui déteste la souffrance et le mal ; qui préfère les malades aux bien-portants, les exclus aux bien-rangés, les faibles aux puissants, les petits aux grands, les pauvres aux riches, servir qu’être servi.
Jésus a annoncé que tous ont un accès direct à ce Dieu, à son Dieu. Il a déclaré que son Dieu est accessible à tous sans aucun intermédiaire, sans la médiation d’aucune religion, d’aucun temple, d’aucune hiérarchie cléricale, d’aucun sacerdoce, d’aucun droit canonique, d’aucun culte religieux, d’aucun sacrement. Car son Dieu est une Force d’amour qui habite les profondeurs de chaque personne.
Toute l’existence de Jésus a été enracinée en ce type de Dieu et a découlé de l’intimité unique qu’il a réussi à vivre avec lui. Jésus a tellement expérimenté Dieu comme Énergie Amoureuse, il s’est tellement senti aimé et porté par elle, qu’il n’a pas pu faire autre chose que de la répercuter dans ses attitudes et ses actions et d’aimer lui aussi à la façon du Dieu qui l’habitait.
Jésus s’est senti voulu et accepté par ce Dieu d’une manière si totale et si définitive qu’à son tour il a accepté tout le monde et il a permis à tous, sans aucune distinction de race, de nationalité et de religion, de profiter de sa sagesse, de ses dons et de ses charismes. De sorte que l’on peut affirmer que Jésus a vraiment « incarné », pour les humains qui l’ont fréquenté, la présence, les sentiments et les attitudes amoureuses de son Dieu. En Jésus, ce Dieu a montré un visage d’homme. En Jésus ce Dieu s’est totalement humanisé.
L’homme universel
Dans cette nouvelle vision des choses, Jésus n’a plus besoin d’être considéré et cru comme étant l’incarnation substantielle et métaphysique de Dieu (comme l’exige le dogme chrétien). Jésus de Nazareth a de la valeur en soi, pour son extraordinaire sensibilité spirituelle ; pour la qualité humaine exceptionnelle de sa personne ; pour l’importance de son message ; pour le rôle qu’il a joué et la tâche qu’il a accomplie dans l’histoire humaine. Il n’a donc aucun besoin d’être enrobé du nimbe de la divinité, pour qu’il apparaisse à nos yeux un cadeau du ciel offert à cette boiteuse, mais surprenante humanité.
La présence de Jésus dans notre monde acquiert une valeur humaine non seulement exemplaire, mais aussi universelle, puisqu’elle semble constituer l’émergence d’une nouvelle phase évolutive de l’humanité au cours de laquelle celle-ci est destinée à prendre un nouvel essor vers une plus grande plénitude et une plus grande perfection d’être, parce qu’activée et conduite par la même qualité d’amour vécue par Jésus.
Aujourd’hui, grand nombre de penseurs chrétiens, familiers avec les connaissances et les découvertes de l’astrophysique moderne, sont en effet enclins à voir en Jésus de Nazareth un catalyseur et un capteur de cette mystérieuse Énergie « amoureuse » de fond, créatrice d’attractions, de connexions, de liaisons, d’interrelations, de communion qui relient et unissent toute chose dans un Tout ordonné et finalisé, afin de faire de l’Univers non pas un « chaos », mais un « cosmos ». En Jésus, le Mystère de cette Force d’amour est devenu la forme de son âme et l’âme de sa vie.
De sorte que, dans cette nouvelle vision, Jésus n’est plus un être sorti des profondeurs transcendantes et surnaturelles de Dieu, mais un être sorti, comme tout humain, des profondeurs de la matière et un produit particulièrement bien réussi de l’évolution de celle-ci vers la complexité.
Cela signifie que cette qualité d’amour gratuit et inconditionnel que nous voyons à l’œuvre dans la vie de Jésus et qui se manifeste comme une attitude et une qualité de fond de son être, n’a rien ni de « divin », ni de « surnaturel », ni de « sacré », ni de « religieux ». Elle est totalement indépendante des croyances, des révélations, des attitudes et des pratiques venant d’une religion. En Jésus, cette nouvelle qualité d’amour surgit « naturellement » de son être humain et de son cœur de chair.
C’est pour cela que Jésus a une valeur universelle. Il constitue en effet pour les individus de notre race un véritable « évangile » ou « bonne nouvelle » qui annonce qu’il est possible, qu’il est nécessaire, qu’il est urgent de tisser la trame de notre vie, de nos relations et de notre société avec le fil de l’amour gratuit, si l’on veut bâtir un monde diffèrent, plus habitable, plus juste, plus accompli et plus heureux, car plus humain.
Comme le faisait opportunément remarquer Villamayor Santiago, la « transcendance », l’importance et l’unicité de Jésus de Nazareth ne sont pas données par sa « nature divine », ni par une Rédemption surnaturelle qui aurait été accomplie par sa mort « sacrificielle », mais par le fait que l’amour gratuit et désintéressé, a trouvé en lui sa plus complète et saisissante expression.
Pour conclure, j’ajouterais que Jésus est unique aussi parce qu’il a accepté de se faire tuer plutôt que de renoncer à ses convictions les plus chères et les plus profondes, ainsi qu’à la mission qu’il s’était donné d’annoncer et de faire comprendre, à qui voulait bien l’écouter, que chaque humain est capable d’aimer comme lui a aimé ; et que chacun est appelé à incarner un tel amour, s’il veut donner du sens à sa présence en ce monde et cela même au prix de sa vie.
Source : «Pour un christianisme sans religion – Retrouver la « Voie » de Jésus de Nazareth, éditions Karthala, p. 190







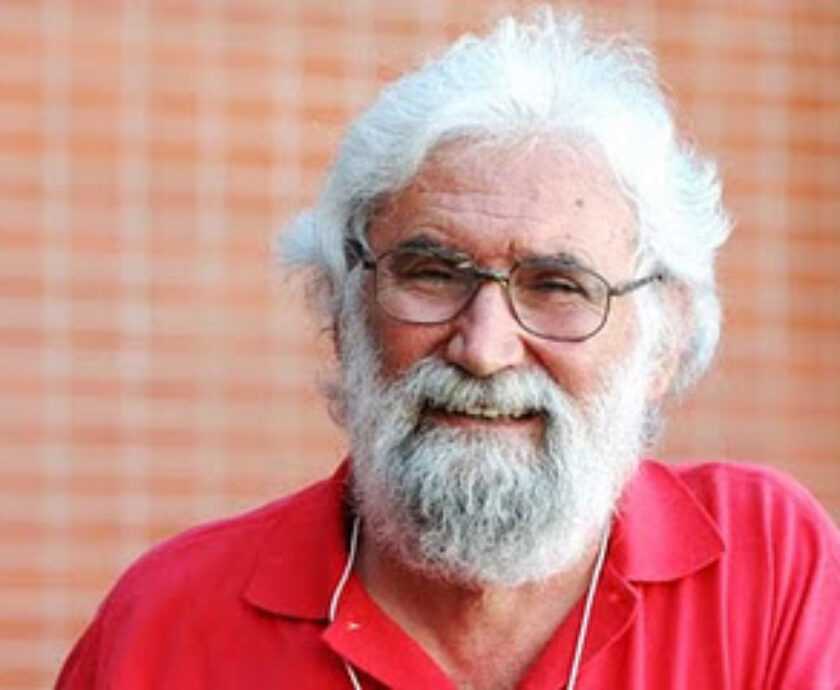
J’aime le passage (le va-et-vient) d’une Révélation codifiée par la religion
à une inspiration révélée par les sciences humaines.
Dureté et rigidité sont compagnons (compagnes) de la mort,
Fragilité et souplesse sont compagnons (compagnes) de la vie.
Lao-Tseu
Le souffle souffle où il veut : tu entends sa voix,
mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va.
Ainsi en est-il de quiconque est né (naît) du souffle.
(Jn 3, 8)
« On pourrait dire . . . que tout être (tout corpuscule) se présente symboliquement à notre expérience comme une ellipse tracée sur deux foyers d’inégale « puissance » : un foyer d’arrangement matériel ou de complexité, F1 ; et un foyer de conscience (ou d’intériorité), F2.
Au cours de la Prévie, l’activité de F2 est pratiquement nulle (domaine du Hasard). Puis, graduellement, l’activité de F2 s’élève au fil de la Vie, – jusqu’au « Pas de la Réflexion », où l’équilibre se renverse. À partir de l’Homme, c’est F2 qui tend à prendre l’initiative des arrangements faisant monter la puissance de F1 (rebondissement de l’Évolution par invention réfléchie) ; en même temps que F2 devient de plus en plus sensible (jusqu’à se renverser sur lui) à l’attrait toujours croissant et finalement exclusif d’Oméga.
Ce qui revient à dire que tout se passe, au cours de l’enroulement cosmique, comme si, graduellement, c’était la super-structure (psychique), au lieu de l’infra-structure (physique) qui devient la portion consistante des particules vitalisées. »
(Paris, 4 août 1949 – « La place de l’Homme dans la Nature » – page 173 – Œuvres de Teilhard de Chardin)
“Si Jésus a été un homme profondément religieux, on peut affirmer que sa religiosité ne lui venait pas de son adhésion à une religion et à ses pratiques, mais de l’originalité de ses convictions, de la qualité de son humanité, de l’intensité de sa vie spirituelle et de l’intimité amoureuse avec laquelle il vivait sa relation personnelle avec le Mystère Ultime de Dieu qu’il appelait « Père » ” ; autrement dit Jésus était, et est “en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire le signe et l’instrument de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain.” (Lumen Gentium n° 1)
Très beau texte, merci…
Deux remarques de détail:
-1- Je cite le texte : “C’est pour cela que Jésus a une valeur universelle. Il constitue en effet pour les individus de notre race un véritable « évangile » ou « bonne nouvelle » qui annonce qu’il est possible […]”.
Dans ce paragraphe le mot “race” n’est pas approprié, il faut le remplacer par le mot “espèce” car il s’agit non pas d’une “race ” (mot qui n’a d’ailleurs pas de consistance scientifique solide) mais de l’espèce humaine.
-2- Je cite à nouveau le texte : “. Le Jésus adulte au début de la trentaine dont parlent les évangiles, était probablement un homme marié […]”.
On aurait aimé connaître sur quoi se fonde l’auteur pour motiver cette assertion.