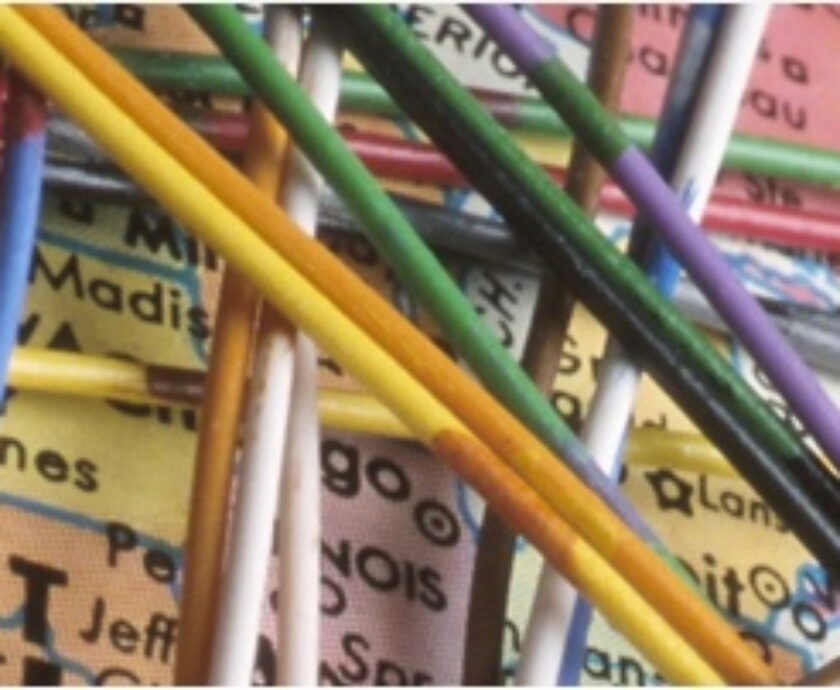Par Jacques Musset

Le titre provocateur du livre de Dominique Collin, dominicain belge, reprend une citation de Soren Kierkegard (1813-1855), philosophe et théologien danois de la première moitié du XIXe siècle. À son époque, il interrogeait le christianisme de chrétienté, sociologique et routinier, qui ne s’était pas laissé questionner par la vigueur de la parole évangélique.
Aujourd’hui, la chrétienté est moribonde et la parole chrétienne laisse indifférents la majorité de nos contemporains occidentaux, car elle est, nous dit Dominique Collin, une sorte de contrefaçon de l’Évangile. En effet pour lui, « L’Évangile n’est pas le message fondateur d’une tradition religieuse particulière (le christianisme) possédant ses croyances et ses normes (rituelles et morales), mais une qualité de la parole elle-même quand elle s’adresse à quelqu’un pour lui dire qu’il est possible d’exister autrement. Cela voudrait dire que l’Évangile est l’à-venir de l’humain. C’est peut-être de ne pas avoir entendu cette « bonne nouvelle » qui expliquerait pourquoi l’Évangile est encore inouï et inédit » (p. 14). Dans les trois parties de son ouvrage, l’auteur s’en explique d’une manière précise.
1- Dans une première partie, Dominique Collin montre en quoi le christianisme existant n’est pas à la hauteur de la Parole évangélique qui est censé l’inspirer. Pour le faire comprendre, il invente le mot « in-existance » qu’il oppose à celui d’inexistence. Inexistence signifie absence d’existence et absence d’importance. Le mot « in-existance », avec son préfixe « in » (qui indique le contraire), désigne une réalité qui n’existe pas encore. S’agissant du christianisme, ce concept oriente vers un à-venir du christianisme qui n’est pas encore présent, mais qui nous appelle à le faire exister… Il reste à accomplir » (p. 16). « Il est la part manquante du christianisme qui fait voir la ressource largement insoupçonnée de l’Évangile » (p. 17).
Il oppose aussi deux formes de christianisme. Le christianisme d’appartenance renvoie à une appartenance religieuse extérieurement identifiable ; on peut en faire partie, quelle que soit l’adhésion qu’on y porte. Le christianisme d’expérience, lui, désigne l’expérience de ceux qui suivent la Voie de l’Évangile. Il est celui pour qui « le Christ est celui qui nous précède sur le chemin d’une vie nouvelle » (p. 31). Le seul baptême reçu et la pratique dominicale ne suffisent pas.
D. Collin introduit encore une autre distinction féconde entre histoire et historicité. « L’histoire relève du passé et archive les faits »… « L’historicité désigne « la valeur d’événement qu’un fait peut signifier pour quelqu’un (ou pour un groupe) » (p.32). L’historicité du christianisme, c’est, pour les disciples de Jésus, l’exigence d’actualiser en permanence la parole de l’Évangile de sorte qu’elle devienne un événement pour eux-mêmes et possiblement pour leurs contemporains, ici et maintenant non pas à la fin des temps), mais ici et maintenant (le temps de la fin).
Enfin, pour D. Collin, « Il s’agit moins de réformer dans un sens ou dans un autre que de nous conformer à ce à quoi l’Évangile nous promet ; conformation qui n’est possible que par une métanoïa qui nous oblige à tout reprendre à neuf. Elle est la condition permanente du christianisme, ce qui veut dire qu’il ne peut jamais s’installer » (p. 47).
2- Dans une seconde partie, D. Collin, dénonce longuement ce qu’il appelle « les maux de la parole chrétienne » : transformation de la parole évangélique en croyances doctrinales, « langage de la bondieuserie » à l’opposé du bien-dire évangélique, langue de buis, bavardage, bla-bla, prêchi-prêcha qui rabâche et ressasse et renforce les croyances sans inciter au risque de la foi.
Les causes de ces dérapages et perversions viennent, selon lui, de ce que la Parole évangélique dans sa force percutante dérange et déçoit spontanément les hommes dans leurs habitudes. Ils s’arrangent pour la faire entrer dans leurs cadres habituels et la décliner en croyance doctrinale et moralisante. Ce christianisme de chrétienté n’est pas crédible, car il ne rejoint pas l’existence des gens.
À sa différence, l’Évangile n’est « une heureuse nouvelle que pour celui qui ose se dépendre de lui-même, celui qui abandonne la sécurité que lui offre le vraisemblable et le possible, qui ose tourner le dos au « moi » qu’il est pour oser s’aventurer en direction du « soi » qu’il pourrait devenir (non pas en puissance ou potentiel, mais comme possible). Le moi : l’illusion qui me fait croire que je suis quelqu’un. Le soi : qui je suis en réalité et qui, pour cette raison, n’existe pas… encore ». Le christianisme n’est véridique que quand il dit comment le soi passe par la déprise du moi… On vérifie l’écoute de l’Évangile à la déception qu’il provoque, car personne, à moins d’être déjà un « soi », ne veut perdre son « moi » (p. 62-63).
3- La dernière partie de son livre, D. Collin l’a intitulée : « Rendre possible le christianisme ». La parole évangélique qui, à première vue, apparaît comme invraisemblable et impossible, loin de conduire vers un merveilleux imaginaire, achemine vers le seul et vrai miracle digne de ce nom pour un humain, à savoir provoquer « l’émergence d’un soi enfin existant » (p. 141).
Le « miracle » de l’existence, D. Collin le voit à l’œuvre dans les récits de miracles des évangiles, interprétés symboliquement. En effet, « Les maladies dont Jésus prend soin apparaissent comme les manifestations différenciées d’un unique mal-être : ne pas être soi » (p. 147). Si la parole évangélique appelle à « exister » celui qui prend le risque de l’accueillir, elle devient par lui « communication d’existence » pour d’autres. « Se fier à une parole-promesse qui fait exister, c’est ce que la Bible appelle la foi » (p. 149). Le croyant est celui qui croit à cette foi, qu’il soit religieux ou non, et qui la met en pratique dans l’ici et le maintenant de son existence en tous ses domaines, comme contestation « de l’ordre des choses, de la voix emprisonnée dans le calculable et le manipulable, la mesure d’audience. » (p. 62). En ce sens, ce christianisme « introduit au cœur du monde un principe critique visant à fracturer l’hégémonie de l’avoir et du pouvoir dans la transformation des rapports humains » (p. 164). Confesser (ainsi) le Christ, c’est proclamer que Dieu est Dieu-pour-l’homme et c’est reconnaître en lui la figure de celui que je deviens quand j’existe enfin. »
Le livre de D. Collin est un grand livre. C’est un ouvrage-feu d’artifice, car il abonde en phrases chocs bien venues qui résument et redisent sur tous les tons ce qu’est la parole évangélique et ses contrefaçons. C’est aussi un livre très profond qui s’essaie à dire l’essentiel du christianisme évangélique dans des catégories en phase avec les attentes de nos contemporains qui désirent vivre vrai. C’est enfin un livre courageux va à l’encontre du christianisme officiel et de la manière dont il est enseigné, exprimé, bétonné, célébré, comme système dogmatique, clérical, moralisant.